| |
Jeudi 23 juin 2011
Au programme de cette journée
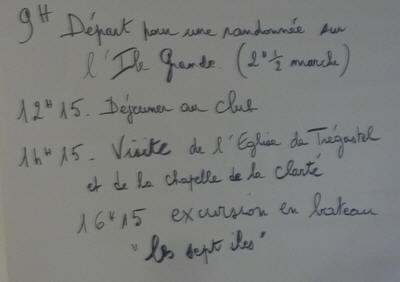
L' Île Grande.
Après sa journée de repos, Jean-Paul, notre chauffeur, paraît des plus
affûtés.
En tout cas, il ébranle son engin aux 1.200.000 kilomètres au compteur
sans fausse note. Même si l'habitacle ne parvient plus à cacher les
vicissitudes et autres séquelles de l'âge, le moteur lui ronronne comme un
chat au coin du feu.
En avant donc pour une balade autour de cette grande île. On a coutume de dire
que les Marseillais ont le chic de gonfler leurs assertions au point
qu'une de leur sardine parvient à boucher l'entrée du port , eh bien, je
crains que les Bretons du coin ne sont pas en reste puisqu'ils affublent
de "grande" une île qui fait tout juste 2 kilomètres dans sa plus grande
largeur. Et, par ailleurs, si "île" elle fut, il a suffit d'un pont d'une
vingtaine de mètres de longueur pour lui faire reperdre son
insularité (pourquoi écrire "reperdre",
parce que dans des temps reculés elle était
rattachée naturellement au continent) . , eh bien, je
crains que les Bretons du coin ne sont pas en reste puisqu'ils affublent
de "grande" une île qui fait tout juste 2 kilomètres dans sa plus grande
largeur. Et, par ailleurs, si "île" elle fut, il a suffit d'un pont d'une
vingtaine de mètres de longueur pour lui faire reperdre son
insularité (pourquoi écrire "reperdre",
parce que dans des temps reculés elle était
rattachée naturellement au continent) .
|

Circuit circulaire : 8 km - 2 h.30 de marche |
Le car nous dépose au coin d'une petite route
asphaltée. Après que Pierre e ut expliqué au groupe des "moindres
distances" les possibilités de courtes balades, le gros du troupeau
s'élance à sa suite pour immédiatement se faire stopper dans son élan
auprès d'une fontaine, la Fontaine Saint-Sauveur. Située en bordure de
route menant au port, cette fontaine fut édifiée en 1665 (à
1 an près (1664) elle eut été une "fontaine à bière).
Elle est connue pour prédire le destin de l'union de deux fiancés. Ceux-ci
doivent chacun jeter un morceau de pain dans l'eau. Si les deux mies se
rencontrent, c'est un bon présage. Si elles se séparent, il vaut mieux
annuler les noces. ut expliqué au groupe des "moindres
distances" les possibilités de courtes balades, le gros du troupeau
s'élance à sa suite pour immédiatement se faire stopper dans son élan
auprès d'une fontaine, la Fontaine Saint-Sauveur. Située en bordure de
route menant au port, cette fontaine fut édifiée en 1665 (à
1 an près (1664) elle eut été une "fontaine à bière).
Elle est connue pour prédire le destin de l'union de deux fiancés. Ceux-ci
doivent chacun jeter un morceau de pain dans l'eau. Si les deux mies se
rencontrent, c'est un bon présage. Si elles se séparent, il vaut mieux
annuler les noces. Nantis de ce viatique de réflexion,
nous voici partis à la queue leu leu sur le sentier qui fait en à peu près
7
 kilomètres le tour de l'île. Apercevant à notre droite l'île de Molène,
propriété du Conservatoire du Littoral (elle abriterait,
selon Pierre, le plus gros galet connu du monde), nous cheminons entre fougères, prunelliers
(ou arbrisseaux ressemblant), troènes et ronces. Quelques champs cultivés
aussi (maïs, pommes de terre, fourrages) attestent de la présence de l'un
ou l'autre cultivateur. kilomètres le tour de l'île. Apercevant à notre droite l'île de Molène,
propriété du Conservatoire du Littoral (elle abriterait,
selon Pierre, le plus gros galet connu du monde), nous cheminons entre fougères, prunelliers
(ou arbrisseaux ressemblant), troènes et ronces. Quelques champs cultivés
aussi (maïs, pommes de terre, fourrages) attestent de la présence de l'un
ou l'autre cultivateur.

Chemin faisant, nous nous faisons expliquer
les plantes halophiles qui ne poussent que dans les milieux salés.
 Malgré notre
atavique chauvinisme alsacien, nous devons reconnaître que la signalisation
des sentiers est bien faite. Toutefois, contrairement à notre randonnée de hier, à Ploumanach, les paysages sont moins pittoresques. De rose le granit est
passé au gris. D'ailleurs, nous verrons vers la fin du parcours
les vestiges de carrières ouvertes au 19e siècle (on en comptait jusqu'à
14) dont on extrayait 800 tonnes de granit gris par jour. Les
pierres extraites servirent à bâtir non seulement les maisons d'Île
Grande, mais également et surtout des monuments funéraires, des quais de
gare ou maritimes à travers toute la France. La dernière de ces carrières
dont l'exploitation constitua longtemps l'activité principale de l'île, n'a été
fermée que récemment, vers la fin des années 80. Malgré notre
atavique chauvinisme alsacien, nous devons reconnaître que la signalisation
des sentiers est bien faite. Toutefois, contrairement à notre randonnée de hier, à Ploumanach, les paysages sont moins pittoresques. De rose le granit est
passé au gris. D'ailleurs, nous verrons vers la fin du parcours
les vestiges de carrières ouvertes au 19e siècle (on en comptait jusqu'à
14) dont on extrayait 800 tonnes de granit gris par jour. Les
pierres extraites servirent à bâtir non seulement les maisons d'Île
Grande, mais également et surtout des monuments funéraires, des quais de
gare ou maritimes à travers toute la France. La dernière de ces carrières
dont l'exploitation constitua longtemps l'activité principale de l'île, n'a été
fermée que récemment, vers la fin des années 80.

Nous nous arrêtons un petit moment près de la base nauti que de
l'île. Un monument y est érigé au bord de la plage rappelant un haut fait
de résistance : des officiers de la Royal Navy venant chercher ici même
les précieux renseignements recueillis entre janvier
et août 1944 par le réseau de combattants ALIBI. que de
l'île. Un monument y est érigé au bord de la plage rappelant un haut fait
de résistance : des officiers de la Royal Navy venant chercher ici même
les précieux renseignements recueillis entre janvier
et août 1944 par le réseau de combattants ALIBI.
Bien du temps a passé depuis. Et on peut s'interroger si les jeunes qui
s'initient ce matin à la voile, juste en-dessous de nous, mesurent
la chance qui est la leur de pouvoir s'adonner un jour à ce magnifique
sport en toute liberté !
 Alors que nous longeons à présent une plage rocailleuse où les vagues de
la marée montante viennent se briser en une écume blanche comme du lait,
se dresse à notre gauche, surplombant un maquis vert, un gros rocher gris.
C'est, selon Pierre, le point culminant de l'île, 62 m. Quelques'uns y
grimpent, sans doute histoire de pérenniser l'adage du Club des
Randonneurs : "un sommet par jour". Alors que nous longeons à présent une plage rocailleuse où les vagues de
la marée montante viennent se briser en une écume blanche comme du lait,
se dresse à notre gauche, surplombant un maquis vert, un gros rocher gris.
C'est, selon Pierre, le point culminant de l'île, 62 m. Quelques'uns y
grimpent, sans doute histoire de pérenniser l'adage du Club des
Randonneurs : "un sommet par jour".
 Mais le gros de la troupe suit
Pierre qui nous emmène auprès d'un dolmen. Il se distingue des dolmens
qu'on a l'habitude de voir par le fait qu'il est tout en longueur. Un
panneau explicatif indique que ce type de vestige préhistorique est
appelé non par ceux qui, il y a quelques millénaires, l'ont érigé mais par
ceux qui se disent "homo sapiens sapiens" : Allée couverte. Mais le gros de la troupe suit
Pierre qui nous emmène auprès d'un dolmen. Il se distingue des dolmens
qu'on a l'habitude de voir par le fait qu'il est tout en longueur. Un
panneau explicatif indique que ce type de vestige préhistorique est
appelé non par ceux qui, il y a quelques millénaires, l'ont érigé mais par
ceux qui se disent "homo sapiens sapiens" : Allée couverte.
 Après les carrières de granit
que nous repérons grâce aux vestiges de rails de
chemin de fer, nous voici parvenu à la station ornithologique de l'île. Le
centre n'est malheureusement ouvert que les après-midi. Nous sommes
intrigués par ces oiseaux de couleur blanche et noire qui semblent collés
contre les parois d'un barrage destiné à retenir l'eau utilisée pour le démazoutage. A notre gauche, le "sanatorium" de convalescence des oiseaux
"nettoyés". Après les carrières de granit
que nous repérons grâce aux vestiges de rails de
chemin de fer, nous voici parvenu à la station ornithologique de l'île. Le
centre n'est malheureusement ouvert que les après-midi. Nous sommes
intrigués par ces oiseaux de couleur blanche et noire qui semblent collés
contre les parois d'un barrage destiné à retenir l'eau utilisée pour le démazoutage. A notre gauche, le "sanatorium" de convalescence des oiseaux
"nettoyés".
Parvenus près d'un terrain de camping surtout occupé par des camping-cars, Pierre
propose à ceux qui voudraient écourter de le suivre, les autres continuant
le chemin qui doit les reconduire à la Fontaine Sa-Sauveur et de là au
car. Il est un peu plus de 11 h.30 lorsque nous y arrivons. Les deux GPS
de randonnée indiquent 7,95 km pour l'un, 8 km pile pour l'autre.
Arrivés au Club Ste-Anne, il est juste l'heure de nous rendre au
restaurant. C'est ce que nous faisons sans passer par la case "chambre".
(Gérard Atzenhoffer)
La première partie l'APRES-MIDI fut consacrée à la visite de
l'église Sainte-Anne de Trégastel. C'est un monument daté de la
fin du 12ème ou du début du 13ème siècle mais dont des ajouts ou
restaurations successives se sont succédés jusqu'au 18e siècle. Quant au
clocher, il a été reconstruit en 1895.
 Après cette première visite, nous nous sommes rendus à environ 300 m de là
au "Mont Calvaire". Monument construit dans les années 1870 par la
population paysanne locale. Appelé couramment calvaire de Trégastel,
c'est un chemin de croix extérieur jalonné de petits oratoires et de
plaques de marbres portant des sentences en langue bretonne échelonnés sur
un parcours en forme de spirale qui conduit à une croix dressée sur un
soubassement en moellons de granite. Après cette première visite, nous nous sommes rendus à environ 300 m de là
au "Mont Calvaire". Monument construit dans les années 1870 par la
population paysanne locale. Appelé couramment calvaire de Trégastel,
c'est un chemin de croix extérieur jalonné de petits oratoires et de
plaques de marbres portant des sentences en langue bretonne échelonnés sur
un parcours en forme de spirale qui conduit à une croix dressée sur un
soubassement en moellons de granite.
Il nous fallut presser le pas (horaire du bateau obligeant)
pour aller encore découvrir la chapelle de Notre- Dame-de-la-Clarté
ou ITRON VARIA AR SKLERDER en breton.
De style gothique flamboyant, située sur le point culminant du petit
bourg de Clarté, sa construction, réalisée en pierres de granit rose, a
commencé en 1445 mais ne fut terminée qu'au 17e siècle. Quelques'uns
d'entre nous ont la surprise de croiser dans le choeur un couple de "super
seniors" dont les parents du mari, né entre 1895 et 1900, étaient
originaires de Schirmeck. Les impératifs de notre rendez-vous au bateau
nous obligèrent à écourter l'évocation des souvenirs de leur arrivée en
France de l'intérieur après la guerre de 14/18. Dame-de-la-Clarté
ou ITRON VARIA AR SKLERDER en breton.
De style gothique flamboyant, située sur le point culminant du petit
bourg de Clarté, sa construction, réalisée en pierres de granit rose, a
commencé en 1445 mais ne fut terminée qu'au 17e siècle. Quelques'uns
d'entre nous ont la surprise de croiser dans le choeur un couple de "super
seniors" dont les parents du mari, né entre 1895 et 1900, étaient
originaires de Schirmeck. Les impératifs de notre rendez-vous au bateau
nous obligèrent à écourter l'évocation des souvenirs de leur arrivée en
France de l'intérieur après la guerre de 14/18.

notre parcours : 1 |
VISITE de l'archipel des
SEPT-ÎLES,
ensemble d'îlots rocheux formant un site naturel protégé depuis 1912
et classé Réserve Naturelle en 1976. L'archipel, qui s'étend sur 9
km, abrite 27 espèces d'oiseaux nicheurs, soit plus de 25 couples.
C'est sur l'île de Rouzic que se concentre la majorité des oiseaux. C'est
un spectacle proprement hallucinant que d'observer ces dizaines de milliers
d'oiseaux en cours de vol ou, pour le plus grand nombre, en colonies serrées
sur ce flanc de rocher. Leurs cris stridents, leurs vols en piqué au-dessus
du bateau m'a fait penser au fameux film de Hitchcock "les Oiseaux". Sur les
autres îles la présence d'oiseaux était moins spectaculaire, quelques
cormorans huppés en train de se sécher au soleil, des macareux moine
s'ébattant joyeusement dans l'eau.
Entre l'île de Bono et aux Moines nous pouvons observer un gros phoques qui
paresse sur un rocher en partie immergé |
 |
 |
Il est 17 h.30 lorsque nous retrouvons nos place dans le car Josy, heureux
d'une journée aux activités variées alternant marche, visites et promenade
en mer et une programmation digne des meilleures agences de voyages. (Gérard
Atzenhoffer)
|
|
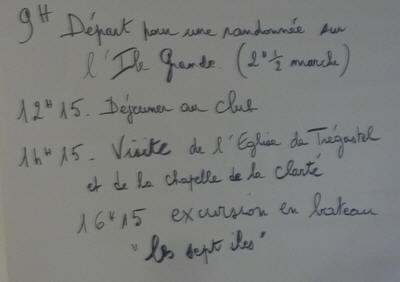
 , eh bien, je
crains que les Bretons du coin ne sont pas en reste puisqu'ils affublent
de "grande" une île qui fait tout juste 2 kilomètres dans sa plus grande
largeur. Et, par ailleurs, si "île" elle fut, il a suffit d'un pont d'une
vingtaine de mètres de longueur pour lui faire reperdre son
insularité (pourquoi écrire "reperdre",
parce que dans des temps reculés elle était
rattachée naturellement au continent) .
, eh bien, je
crains que les Bretons du coin ne sont pas en reste puisqu'ils affublent
de "grande" une île qui fait tout juste 2 kilomètres dans sa plus grande
largeur. Et, par ailleurs, si "île" elle fut, il a suffit d'un pont d'une
vingtaine de mètres de longueur pour lui faire reperdre son
insularité (pourquoi écrire "reperdre",
parce que dans des temps reculés elle était
rattachée naturellement au continent) . 
 ut expliqué au groupe des "moindres
distances" les possibilités de courtes balades, le gros du troupeau
s'élance à sa suite pour immédiatement se faire stopper dans son élan
auprès d'une fontaine, la Fontaine Saint-Sauveur. Située en bordure de
route menant au port, cette fontaine fut édifiée en 1665 (à
1 an près (1664) elle eut été une "fontaine à bière).
Elle est connue pour prédire le destin de l'union de deux fiancés. Ceux-ci
doivent chacun jeter un morceau de pain dans l'eau. Si les deux mies se
rencontrent, c'est un bon présage. Si elles se séparent, il vaut mieux
annuler les noces.
ut expliqué au groupe des "moindres
distances" les possibilités de courtes balades, le gros du troupeau
s'élance à sa suite pour immédiatement se faire stopper dans son élan
auprès d'une fontaine, la Fontaine Saint-Sauveur. Située en bordure de
route menant au port, cette fontaine fut édifiée en 1665 (à
1 an près (1664) elle eut été une "fontaine à bière).
Elle est connue pour prédire le destin de l'union de deux fiancés. Ceux-ci
doivent chacun jeter un morceau de pain dans l'eau. Si les deux mies se
rencontrent, c'est un bon présage. Si elles se séparent, il vaut mieux
annuler les noces. kilomètres le tour de l'île. Apercevant à notre droite l'île de Molène,
propriété du Conservatoire du Littoral (elle abriterait,
selon Pierre, le plus gros galet connu du monde), nous cheminons entre fougères, prunelliers
(ou arbrisseaux ressemblant), troènes et ronces. Quelques champs cultivés
aussi (maïs, pommes de terre, fourrages) attestent de la présence de l'un
ou l'autre cultivateur.
kilomètres le tour de l'île. Apercevant à notre droite l'île de Molène,
propriété du Conservatoire du Littoral (elle abriterait,
selon Pierre, le plus gros galet connu du monde), nous cheminons entre fougères, prunelliers
(ou arbrisseaux ressemblant), troènes et ronces. Quelques champs cultivés
aussi (maïs, pommes de terre, fourrages) attestent de la présence de l'un
ou l'autre cultivateur. 
 Malgré notre
atavique chauvinisme alsacien, nous devons reconnaître que la signalisation
des sentiers est bien faite. Toutefois, contrairement à notre randonnée de hier, à Ploumanach, les paysages sont moins pittoresques. De rose le granit est
passé au gris. D'ailleurs, nous verrons vers la fin du parcours
les vestiges de carrières ouvertes au 19e siècle (on en comptait jusqu'à
14) dont on extrayait 800 tonnes de granit gris par jour. Les
pierres extraites servirent à bâtir non seulement les maisons d'Île
Grande, mais également et surtout des monuments funéraires, des quais de
gare ou maritimes à travers toute la France. La dernière de ces carrières
dont l'exploitation constitua longtemps l'activité principale de l'île, n'a été
fermée que récemment, vers la fin des années 80.
Malgré notre
atavique chauvinisme alsacien, nous devons reconnaître que la signalisation
des sentiers est bien faite. Toutefois, contrairement à notre randonnée de hier, à Ploumanach, les paysages sont moins pittoresques. De rose le granit est
passé au gris. D'ailleurs, nous verrons vers la fin du parcours
les vestiges de carrières ouvertes au 19e siècle (on en comptait jusqu'à
14) dont on extrayait 800 tonnes de granit gris par jour. Les
pierres extraites servirent à bâtir non seulement les maisons d'Île
Grande, mais également et surtout des monuments funéraires, des quais de
gare ou maritimes à travers toute la France. La dernière de ces carrières
dont l'exploitation constitua longtemps l'activité principale de l'île, n'a été
fermée que récemment, vers la fin des années 80.
 que de
l'île. Un monument y est érigé au bord de la plage rappelant un haut fait
de résistance : des officiers de la Royal Navy venant chercher ici même
les précieux renseignements recueillis entre janvier
et août 1944 par le réseau de combattants ALIBI.
que de
l'île. Un monument y est érigé au bord de la plage rappelant un haut fait
de résistance : des officiers de la Royal Navy venant chercher ici même
les précieux renseignements recueillis entre janvier
et août 1944 par le réseau de combattants ALIBI.  Alors que nous longeons à présent une plage rocailleuse où les vagues de
la marée montante viennent se briser en une écume blanche comme du lait,
se dresse à notre gauche, surplombant un maquis vert, un gros rocher gris.
C'est, selon Pierre, le point culminant de l'île, 62 m. Quelques'uns y
grimpent, sans doute histoire de pérenniser l'adage du Club des
Randonneurs : "un sommet par jour".
Alors que nous longeons à présent une plage rocailleuse où les vagues de
la marée montante viennent se briser en une écume blanche comme du lait,
se dresse à notre gauche, surplombant un maquis vert, un gros rocher gris.
C'est, selon Pierre, le point culminant de l'île, 62 m. Quelques'uns y
grimpent, sans doute histoire de pérenniser l'adage du Club des
Randonneurs : "un sommet par jour".  Mais le gros de la troupe suit
Pierre qui nous emmène auprès d'un dolmen. Il se distingue des dolmens
qu'on a l'habitude de voir par le fait qu'il est tout en longueur. Un
panneau explicatif indique que ce type de vestige préhistorique est
appelé non par ceux qui, il y a quelques millénaires, l'ont érigé mais par
ceux qui se disent "homo sapiens sapiens" : Allée couverte.
Mais le gros de la troupe suit
Pierre qui nous emmène auprès d'un dolmen. Il se distingue des dolmens
qu'on a l'habitude de voir par le fait qu'il est tout en longueur. Un
panneau explicatif indique que ce type de vestige préhistorique est
appelé non par ceux qui, il y a quelques millénaires, l'ont érigé mais par
ceux qui se disent "homo sapiens sapiens" : Allée couverte. Après les carrières de granit
que nous repérons grâce aux vestiges de rails de
chemin de fer, nous voici parvenu à la station ornithologique de l'île. Le
centre n'est malheureusement ouvert que les après-midi. Nous sommes
intrigués par ces oiseaux de couleur blanche et noire qui semblent collés
contre les parois d'un barrage destiné à retenir l'eau utilisée pour le démazoutage. A notre gauche, le "sanatorium" de convalescence des oiseaux
"nettoyés".
Après les carrières de granit
que nous repérons grâce aux vestiges de rails de
chemin de fer, nous voici parvenu à la station ornithologique de l'île. Le
centre n'est malheureusement ouvert que les après-midi. Nous sommes
intrigués par ces oiseaux de couleur blanche et noire qui semblent collés
contre les parois d'un barrage destiné à retenir l'eau utilisée pour le démazoutage. A notre gauche, le "sanatorium" de convalescence des oiseaux
"nettoyés". 
 Après cette première visite, nous nous sommes rendus à environ 300 m de là
au "Mont Calvaire". Monument construit dans les années 1870 par la
population paysanne locale. Appelé couramment calvaire de Trégastel,
c'est un chemin de croix extérieur jalonné de petits oratoires et de
plaques de marbres portant des sentences en langue bretonne échelonnés sur
un parcours en forme de spirale qui conduit à une croix dressée sur un
soubassement en moellons de granite.
Après cette première visite, nous nous sommes rendus à environ 300 m de là
au "Mont Calvaire". Monument construit dans les années 1870 par la
population paysanne locale. Appelé couramment calvaire de Trégastel,
c'est un chemin de croix extérieur jalonné de petits oratoires et de
plaques de marbres portant des sentences en langue bretonne échelonnés sur
un parcours en forme de spirale qui conduit à une croix dressée sur un
soubassement en moellons de granite.  Dame-de-la-Clarté
ou ITRON VARIA AR SKLERDER en breton.
De style gothique flamboyant, située sur le point culminant du petit
bourg de Clarté, sa construction, réalisée en pierres de granit rose, a
commencé en 1445 mais ne fut terminée qu'au 17e siècle. Quelques'uns
d'entre nous ont la surprise de croiser dans le choeur un couple de "super
seniors" dont les parents du mari, né entre 1895 et 1900, étaient
originaires de Schirmeck. Les impératifs de notre rendez-vous au bateau
nous obligèrent à écourter l'évocation des souvenirs de leur arrivée en
France de l'intérieur après la guerre de 14/18.
Dame-de-la-Clarté
ou ITRON VARIA AR SKLERDER en breton.
De style gothique flamboyant, située sur le point culminant du petit
bourg de Clarté, sa construction, réalisée en pierres de granit rose, a
commencé en 1445 mais ne fut terminée qu'au 17e siècle. Quelques'uns
d'entre nous ont la surprise de croiser dans le choeur un couple de "super
seniors" dont les parents du mari, né entre 1895 et 1900, étaient
originaires de Schirmeck. Les impératifs de notre rendez-vous au bateau
nous obligèrent à écourter l'évocation des souvenirs de leur arrivée en
France de l'intérieur après la guerre de 14/18.

